TOUS LES TITRES

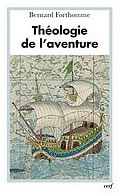
Théologie de l´aventure
La théologie chrétienne est devenue si variée et si enchevêtrée qu’elle apparaît comme une forêt obscure. Osera-t-on encore s’y aventurer ? L’esprit d’aventure est un esprit d’abréviation, de concentration sur le mouvement épuré et sur la tension simplifiée. Il ne s’empêtre pas dans les sédiments historiques, les drames de la liberté, dans le jeu complexe de la volonté ferme et des nécessités de la vie, des émotions et des habitudes dérobées, des inclinations imperceptibles ou de la stratégie des censures. L’esprit d’aventure donne l’audace de parler autrement de l’ineffable ; non seulement de s’adresser à Dieu dans la prière, mais d’oser franchement parler de lui, alors qu’il ne vient au concept qu’à partir d’une assurance filiale confirmée, celle de l’Avent !
Aventure qui retrouve le consentement fraternel à la lumière et aux étoiles sauvages, au souffle des vents, à l’eau des mers et des fleuves, au feu des orages et des volcans, à la terre secouée et aux îles. Aventure qui se risque à faire confiance à ceux qui frayent les voix du verbe premier. Certes, l’aventure peut se montrer cruelle comme l’enfance, jusque dans une certaine insouciance face à la mort, la sienne et celle des autres. C’est un usage simple de la vie qui rompt avec l’existence asservie à l’efficacité et à la procédure sans exception décisive, et voit son accomplissement dans la charité aventurière. Toutefois, pour que la théologie appartienne à l’aventure, il faut qu’une telle audace devienne une expérience véritable, une réception intérieure capable d’épouser son mouvement et sa tension, mais sans prétendre tout épuiser de sa hardiesse inventive.

La théologie chrétienne est devenue si variée et si enchevêtrée qu’elle apparaît comme une forêt obscure. Osera-t-on encore s’y aventurer ? L’esprit d’aventure est un esprit d’abréviation, de concentration sur le mouvement épuré et sur la tension simplifiée. Il ne s’empêtre pas dans les sédiments historiques, les drames de la liberté, dans le jeu complexe de la volonté ferme et des nécessités de la vie, des émotions et des habitudes dérobées, des inclinations imperceptibles ou de la stratégie des censures. L’esprit d’aventure donne l’audace de parler autrement de l’ineffable ; non seulement de s’adresser à Dieu dans la prière, mais d’oser franchement parler de lui, alors qu’il ne vient au concept qu’à partir d’une assurance filiale confirmée, celle de l’Avent !
Aventure qui retrouve le consentement fraternel à la lumière et aux étoiles sauvages, au souffle des vents, à l’eau des mers et des fleuves, au feu des orages et des volcans, à la terre secouée et aux îles. Aventure qui se risque à faire confiance à ceux qui frayent les voix du verbe premier. Certes, l’aventure peut se montrer cruelle comme l’enfance, jusque dans une certaine insouciance face à la mort, la sienne et celle des autres. C’est un usage simple de la vie qui rompt avec l’existence asservie à l’efficacité et à la procédure sans exception décisive, et voit son accomplissement dans la charité aventurière. Toutefois, pour que la théologie appartienne à l’aventure, il faut qu’une telle audace devienne une expérience véritable, une réception intérieure capable d’épouser son mouvement et sa tension, mais sans prétendre tout épuiser de sa hardiesse inventive.
