TOUS LES TITRES

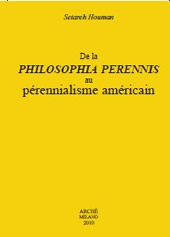
De la Philosophia Perennis au pérennialisme américain
La quête d´une sagesse d´origine non humaine, immuable dans son essence, transmise depuis l´aube de l´humanité mais morcelée et perdue en partie, est un thème récurrent dans l´histoire de l´ésotérisme occidental. Il s´est exprimé, notamment, au début du XXe siècle dans une forme de pensée appelée .traditionalisme. (.l´École Traditionnelle.), surtout à partir du moment où le Français René Guénon s´en fit le porteparole avec ses écrits anti-modernistes. Le terme pérennialisme (perennialism) est synonyme, mais on l´emploie plus spécifiquement à propos de la forme prise aux États-Unis par cette pensée, dont Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Seyyed Hossein Nasr, Huston Smith, et une seconde génération d´auteurs, comme James Cutsinger, figurent parmi les principaux représentants.
Après un développement introductif consacré aux racines du pérennialisme nord-américain - depuis la Renaissance jusqu´au théosophisme moderne et l´oeuvre d´un Ananda K. Coomaraswamy, en passant par les quêtes romantiques et transcendantalistes d´une lumière venue d´Orient - , l´auteur présente l´histoire de ce courant proprement dit aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle jusqu´à aujourd´hui. Elle en décrit les diverses manifestations, notamment au sein de milieux tant académiques qu´artistiques, et fait état des débats qu´il a suscités et continue à susciter. Enfin, elle en souligne certains aspects problématiques, en les soumettant à une interrogation de type historico-critique.
Son ouvrage constitue un apport richement documenté, qualitativement stimulant, aux études et réflexions portant non seulement sur la culture et civilisation nord-américaines en particulier, mais aussi sur un aspect non négligeable du paysage philosophique contemporain en général. Aussi ne saurait-il manquer de retenir l´attention de nombreux lecteurs, d´autant que la précision dans l´articulation du discours se trouve rehaussée par une langue claire et élégante de bout en bout.
Wouter J. HANEGRAAFF :
Avec le présent travail, Setareh Houman livre un ouvrage pionnier et qui n’a d’équivalent actuel en aucune autre langue. Il s’agit en effet d’une contribution exhaustive à l’étude des principaux représentants d’un courant de pensée qui, dans le sillage intellectuel de René Guénon, a profondément renouvelé l’approche et la compréhension du fait religieux, jusque dans le monde anglo-saxon.. Au terme d’un examen d’une exceptionnelle ampleur historique (de la Renaissance à nos jours), S. Houman retrace l’évolution et les transformations successives de l’idée d’une sagesse originelle qui constituerait le fond immuable de tous les messages religieux. À travers l’œuvre de A. K. Coomaraswamy , F. Schuon ou S. H. Nasr , ainsi que de leurs disciples et continuateurs contemporains, c’est le rôle et l’influence politico-spirituels d’un certain “traditionalisme” ésotérique qui sont pris en compte, et se révèlent comme constituant une véritable histoire intellectuelle alternative au sein des cultures occidentale et américaine des XXe et XXIe siècles. « De la philosophia perennis au pérennialisme américain » constitue ainsi une enquête passionnante et une fascinante aventure intellectuelle, qui explore des débats et des enjeux capitaux pour l’avenir de nos sociétés contemporaines.

La quête d´une sagesse d´origine non humaine, immuable dans son essence, transmise depuis l´aube de l´humanité mais morcelée et perdue en partie, est un thème récurrent dans l´histoire de l´ésotérisme occidental. Il s´est exprimé, notamment, au début du XXe siècle dans une forme de pensée appelée .traditionalisme. (.l´École Traditionnelle.), surtout à partir du moment où le Français René Guénon s´en fit le porteparole avec ses écrits anti-modernistes. Le terme pérennialisme (perennialism) est synonyme, mais on l´emploie plus spécifiquement à propos de la forme prise aux États-Unis par cette pensée, dont Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Seyyed Hossein Nasr, Huston Smith, et une seconde génération d´auteurs, comme James Cutsinger, figurent parmi les principaux représentants.
Après un développement introductif consacré aux racines du pérennialisme nord-américain - depuis la Renaissance jusqu´au théosophisme moderne et l´oeuvre d´un Ananda K. Coomaraswamy, en passant par les quêtes romantiques et transcendantalistes d´une lumière venue d´Orient - , l´auteur présente l´histoire de ce courant proprement dit aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle jusqu´à aujourd´hui. Elle en décrit les diverses manifestations, notamment au sein de milieux tant académiques qu´artistiques, et fait état des débats qu´il a suscités et continue à susciter. Enfin, elle en souligne certains aspects problématiques, en les soumettant à une interrogation de type historico-critique.
Son ouvrage constitue un apport richement documenté, qualitativement stimulant, aux études et réflexions portant non seulement sur la culture et civilisation nord-américaines en particulier, mais aussi sur un aspect non négligeable du paysage philosophique contemporain en général. Aussi ne saurait-il manquer de retenir l´attention de nombreux lecteurs, d´autant que la précision dans l´articulation du discours se trouve rehaussée par une langue claire et élégante de bout en bout.
Wouter J. HANEGRAAFF :
Avec le présent travail, Setareh Houman livre un ouvrage pionnier et qui n’a d’équivalent actuel en aucune autre langue. Il s’agit en effet d’une contribution exhaustive à l’étude des principaux représentants d’un courant de pensée qui, dans le sillage intellectuel de René Guénon, a profondément renouvelé l’approche et la compréhension du fait religieux, jusque dans le monde anglo-saxon.. Au terme d’un examen d’une exceptionnelle ampleur historique (de la Renaissance à nos jours), S. Houman retrace l’évolution et les transformations successives de l’idée d’une sagesse originelle qui constituerait le fond immuable de tous les messages religieux. À travers l’œuvre de A. K. Coomaraswamy , F. Schuon ou S. H. Nasr , ainsi que de leurs disciples et continuateurs contemporains, c’est le rôle et l’influence politico-spirituels d’un certain “traditionalisme” ésotérique qui sont pris en compte, et se révèlent comme constituant une véritable histoire intellectuelle alternative au sein des cultures occidentale et américaine des XXe et XXIe siècles. « De la philosophia perennis au pérennialisme américain » constitue ainsi une enquête passionnante et une fascinante aventure intellectuelle, qui explore des débats et des enjeux capitaux pour l’avenir de nos sociétés contemporaines.
